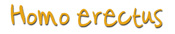
Bon, bien sûr, je suis un mammifère qui se tient debout sur ses deux pattes arrière, mais c’est une autre de mes fonctions que je vise en choisissant pour titre de cet éclat un très potache barbarisme (il faut dire qu’à presque cinquante ans, un rien continue à m’amuser). Car le désir sexuel et le plaisir charnel sont une part importante de ma vie – une part que, contre deux mille ans de paulinisme, je prétends noble.
Si j’ai tant aimé Parce que c’était lui de Roger Stéphane, que j’ai eu le plaisir de préfacer dans sa réédition chez H&O en 2005, c’est qu’en plus de dire la force de l’attachement de Roger pour son ami Jean-Jacques, mortellement blessé dans un accident d’automobile, Stéphane y décrit, en 1952, avec une singulière modernité et une absence totale de fausse pudeur, comment l’attachement, le compagnonnage, dans un couple homosexuel, (Lire l'extrait) peut se conjuguer avec une totale infidélité des corps. Parce que les pédés (je n’aime ni le médical homosexuel ni l’angliciste gay) « sont plus naturellement versatiles que les hétérosexuels », il écrit n’en connaître aucun, « à quelque classe sociale ou intellectuelle qu’il appartienne, qui n’ait souvent cédé à la fascination de la chasse » (pp. 77-78).

Cette chasse-là, je l’ai beaucoup pratiquée (et je la pratique encore), parce que nous avons toujours pensé, Frédéric et moi, qu’il n’y a aucune raison que notre relation nous interdise d’autres expériences sensuelles, voire affectives. Nous n’avons jamais pensé que le fait de prendre du plaisir à vivre ensemble devait supposer ne devoir partager qu’avec l’autre un bon repas, un ouiquende à la neige ou un opéra – surtout si l’un des deux hait le ski et que l’autre n’a aucun goût pour le bel canto –, qu’il n’était pas plus sacré de se mettre au lit qu’à table avec autrui, pas plus immoral de s’offrir ensemble une grande secousse ou une bonne partie de glisse, de partager le plaisir et l’émotion d’un orgasme sexuel ou auditif.
Pourquoi serait-il plus sale ou peccamineux de satisfaire la pulsion sexuelle que l’appétit ? À mes yeux, la divagation érotique ne vise pas à combler un manque, elle ne trahit pas une absence de maîtrise de soi, une incapacité à domestiquer ses instincts. Elle est plutôt élan vers le beau, vers l’autre et la conquête commune d’une étincelle de bonheur –aussi noble que le désir d’apprendre ou d’écrire. Pure de tout réflexe visant à perpétuer l’espèce, seulement dirigée vers et justifiée par le plaisir, elle est au contraire, avec la création artistique, le rire ou la gastronomie, un des marqueurs de l’humanité, de la civilisation. Je soutiendrais même contre les chrétiens (ce qu’ils ont appelé la décadence romaine, par exemple, n’a jamais été une période de relâchement des mœurs, mais exactement le contraire), que la débauche est un indice presque infaillible d’hypercivilisation, d’une société sûre d’elle-même, d’une culture à son apogée qui s’épanouit ; comme le puritanisme annonce les crises, profite des crispations autoritaires, se fait l’indispensable béquille des tétanies totalitaires dont le fantasme – chrétien, avant d’être nazi ou communiste, est de contrôler à la fois les esprits et les corps.
 |
Pour reprendre les catégories des « mes » Grecs, auxquels je reviens toujours, il y a donc ma philia pour Frédéric, cette amitié amoureuse, ce compagnonnage de deux malfrats soudés face au monde, qui nous fait regarder depuis plus de vingt ans dans la même direction, qui nous fait heureux d’être ensemble, de se blottir l’un contre l’autre, de se deviner et de partager silences aussi bien qu’éclats de rire, comme de trouver en l’autre la force de surmonter les moments les plus cruels d’une existence – amour nécessaire auraient dit Sartre et Beauvoir. Et puis il y a Éros, l’énergie primordiale qui, chez Hésiode, donne naissance au monde, avant de devenir le dieu du désir de l’autre, du désir de jouir, de la pulsion sexuelle – celui des amours contingentes, sans qu’elle soient d’ailleurs forcément accessoires ou unidimensionnellement sensuelles.
Les personnages de mes romans qui me sont proches ne vivent et ne disent pas autre chose.
Ainsi d’Alexandre dans Les Ombres du levant. (Lire l'extrait)
Ainsi du narrateur du Château du silence. (Lire l'extrait)
Au demeurant, j’ai pratiqué dans ma vie la partition entre philia et éros bien avant de l’avoir pensée : Primum vivere, deinde philosophari (vivre d’abord, philosopher ensuite), dit un adage des Anciens. Je n’ai commencé à dévorer Michel Onfray qu’à partir de La Sculpture de soi, en 1993, et n’ai découvert que grâce à lui La Mettrie ou les philosophes hédonistes de l’école cyrénaïque. Mais il est important aujourd’hui, pour moi, de pouvoir revendiquer éthiquement ce parti pris de vie qu’Onfray a si bellement nommé libertinage solaire : car ce que j’ai toujours essayé de pratiquer, dans le sexe comme dans mes autres activités, c’est bien de tirer le plus grand plaisir possible de la vie, en en procurant autant que je le peux à celui qui se trouve alors en commerce, charnel ou non, avec moi, et sans nuire à quiconque.
Autant dire que, pour moi, Éros est désir, plaisir, jouissance, pulsion de vie, éclat de lumière, et qu’il n’a rien à fricoter avec Thanatos ; que la secte irresponsable et mortifère des barebakers me débecte autant que son opposé – ou plutôt son miroir –, le sexe coupable, le sexe malédiction. Le sexe chrétien.
Pour être sincère, je dois cependant préciser qu’il n’en a pas toujours été ainsi. J’ai reçu une éducation chrétienne : catéchisme, louveteau, communion, messe du dimanche. Et même si ma famille n’a jamais été particulièrement observante, même si mes parents se sont souciés de l’éducation sexuelle de leurs deux enfants, même si, avec les années, mon père s’est mis à bouffer du curé et que ma mère a lentement dérivé vers l’indifférence, cette partie-là de mon éducation m’a bien inoculé le vieux bacille chrétien du péché originel, de la culpabilité devant le corps, du sexe « sale ».
Alors quand j’ai dû me reconnaître pédé !…
Le triste sire qui fait actuellement fonction de chef de l’État, ce catholique (mais divorcé, donc interdit d’accès à la sainte table : vive la cohérence !) qui souhaite tant voir les Églises prendre plus de place dans la cité, lui qui a fait entrer au gouvernement la pasionaria de la Réaction charitable, devrait s’aviser que si les jeunes homosexuels sont treize fois plus nombreux que les jeunes hétéros à tenter de se suicider, il n’est nul besoin d’y chercher de fumeuses causes génétiques : la pression sociale et les condamnations répétées des trois monothéismes qui l’ont fait naître, qui l’ont cultivée, imposée, diffusée, y suffisent largement.
 |
Car si, en Grèce, l’amour des garçons fut associé à toutes les valeurs positives ; s’il était au moins aussi répandu chez les Germains ; si on ne voit pas qu’en Égypte ou dans l’Orient ancien il ait été d’une façon quelconque traqué ; si les ethnologues ont montré qu’il n’était frappé d’aucune prohibition universelle dans les sociétés primitives ; si donc aucune « loi naturelle » le condamnant n’est décelable, ni dans le temps ni dans l’espace, il est en revanche évident que la névrose développée par les monothéismes à l’égard de la sodomie (non d’un amour sans union charnelle entre êtres du même sexe) trouve sa source dans la tradition juive qui, avec le Lévitique, baptise d’abomination le fait pour un homme de coucher avec un homme comme on couche avec une femme, et promet à ceux qui s’y livrent que leur sang retombera sur eux. Ce à quoi s’emploiera le christianisme, imposant ses règles à l’Empire romain finissant parmi lesquelles, dans le code promulgué par Théodose en 390, celle qui permettra d’envoyer les sodomites au bûcher. En France jusqu’à ce que la Révolution, en 1791, abolisse ce crime de sodomie en le rangeant parmi les crimes imaginaires. Les Églises ont bien dû alors, face à la laïcisation des sociétés occidentales et de leur droit, se résigner à reculer, mais sans renoncer, faute de « mieux », à condamner « moralement » le caractère « intrinsèquement pervers » des pratiques homosexuelles.
Et en attendant de pouvoir imposer quelque version moderne de ce « mieux » si jamais, demain, dans le sillage du dynamisme mahométan qui cultive l’homophobie dans nos banlieues, pend de pauvres gosses à Téhéran ou voue les « abominables » égyptiens aux tortures et aux procès iniques, les Sarkozy et les Boutin (adversaire du Pacs comme de la loi proscrivant le foulard à l’école), sous prétexte de redéfinition d’une laïcité ouverte, imposaient leur révolution néo-conservatrice à notre société. N’oublions jamais cette réflexion, désarmante de sincérité, du grand catholique Louis Veuillot (1813-1833), le véritable ancêtre politique de Boutin : « Quand je suis le plus faible, je vous demande la liberté parce que tel est votre principe. Mais quand je suis le plus fort, je vous l’ôte parce que tel est le mien ». Et N’oublions pas non plus, comme l’a répété une fois de plus le pape Ratzinger avec une ingénuité digne de Veuillot, qu’avoir un Dieu unique signifie que la Vérité de ce Dieu est unique – qu’elle doit donc s’imposer à tous. Le reste n’est que concessions tactiques.
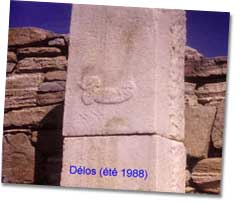 |
Tant qu’il y aura des religions pour condamner, culpabiliser, montrer du doigt, elles donneront aux pires brutes l’idée et les raisons de casser du pédé. Tant qu’il y aura des députés comme Vanneste (que le parti du président eut l’hypocrisie de ne pas investir… tout en ne présentant personne contre lui ; dont le Premier ministre a cru devoir honorer la circonscription de sa première visite post-législative en province) pour professer que les pédés sont des êtres inférieurs aux hétéros, il y aura de bons citoyens pour s’indigner que ces inférieurs réclament l’égalité. Tant qu’il y aura des pères pour répéter devant leurs gosses, dès leur plus tendre enfance, qu’ils préféreraient avoir un fils mort plutôt qu’homosexuel, trop de ces fils-là – comme me l’a confié l’un d’entre eux, en 2004 (pas il y dix, vingt ou trente ans), en m’écrivant que mon Plongeon, acheté et lu en cachette, lui avait peut-être sauvé la vie en lui faisant comprendre qu’il n’était pas seul, qu’il pouvait espérer vivre pédé et heureux – ne se verront pas d’issue entre de tels pères et des copains pour qui « pédé » ne peut être qu’une insulte.
Nul besoin de gènes du suicide, M. le président !
Je n’ai jamais vécu ces extrêmes. Mais j’ai grandi dans un monde où la seule image de l’homosexuel, dans ma petite ville de province, c’était la tante. Une image répercutée par les médias : le sinistre docteur Amoroso demandant à Jean-Louis Bory, au début d’un « débat » télévisé, s’il doit l’appeler monsieur ou madame ; Chazot aux Grosses Têtes ; Serrault dans La Cage aux folles. Même si Zaza Napoli et sa biscotte étaient irrésistibles, même si je riais de bon cœur, adolescent, ce jour de l’an, en matinée, au théâtre, entre mon père et ma grand-mère, je riais jaune : il est difficile, à quatorze ans, de se projeter dans l’avenir avec comme seul modèle un objet de dérision.
Longtemps, j’ai refusé ce que j’étais, je me suis cherché des excuses pour acheter les magazines sur lesquels je me branlais ; longtemps j’ai refoulé mes désirs ; je suis retourné à la messe pour conjurer mes penchants « intrinsèquement pervers ». Je me savais pédé, mais d’une manière bien différente : je voulais ressembler à un homme et baiser avec des hommes qui ne soient pas des caricatures du féminin mais des icônes de la virilité. L’apparition du Gai Pied dans les kiosques, la fin des tracasseries policières et des discriminations pénales en 1981-82, la découverte du Corydon de Gide, des Mémoires d’Hadrien de Yourcenar, du Livre blanc de Cocteau, puis de Kavafis et de… Tom of Finland auront été autant d’étapes qui m’ont permis de me regarder en face, de vivre ce que je suis en abjurant à la fois la honte et sa matrice chrétienne.
Tard ; je ne me suis vraiment déniaisé qu’autour de vingt-quatre ans. Ce qui m’a peut-être sauvé la vie… quelques mois après, Libé titrait sur l’épidémie de « cancer gay ». Moi qui pointais à peine le nez hors de mon placard, qui commençais tout juste à goûter aux plaisirs de la chasse, à vivre heureux en fier pourceau d’Épicure, j’ai pris ce titre comme une gifle et une offense personnelle.
Et puis il a fallu s’y faire ; en véritable hédoniste, protéger l’autre et se protéger, trouver le talent, malgré l’hécatombe et la terrifiante lecture de Guibert, de continuer à jouir, ne pas laisser Thanatos écouiller Éros, la peur terrasser le libertinage solaire.

Restait à solder mes comptes avec ce Paul qu’on dit saint, ce génial apparatchik, véritable concepteur du christianisme qui, sous prétexte d’amour divin, a empoisonné l’Occident avec la haine de la philosophie – qualifiée de vaine supercherie dans l’épître aux Colossiens (2, 8) – à laquelle il préfère les hymnes et les psaumes (idem, 3, 16-17), la haine du corps, du jouir, de la femme et du pédé – toutes formes de la haine de soi. C’est chose faite depuis la sortie de La Quatrième Révélation.
Aujourd’hui, je suis convaincu qu’aimer les garçons est, comme l’écrivait Roger Stéphane dans son journal en 1941, non pas « un phénomène purement sexuel, fragmentaire » mais un « phénomène psychologique totalitaire » destiné à « devenir une éthique ». Aimer les garçons a été pour moi une chance – de rester curieux, en éveil, rétif (par « nature » en quelque sorte) aux conformismes, aux slogans qui ravissent la majorité silencieuse et satisfont la connerie ambiante ; la chance d’essayer d’être un homme libre.
Reste alors, l’âge venant, à tenter de poursuivre la sculpture de soi, sans jamais se prendre tout à fait au sérieux, en gardant le sourire de l’ironie et son corollaire, le souci, comme disait Malraux, de « destruction de la comédie », en sage d’avant la psychose monothéiste, en tirant de la vie tous les plaisirs qu’elle peut me donner – en tâchant d’apprivoiser la mort, suffisamment pour avoir le courage de la choisir lorsque ces plaisirs ne seront plus suffisants pour justifier ma persistance dans l’être.
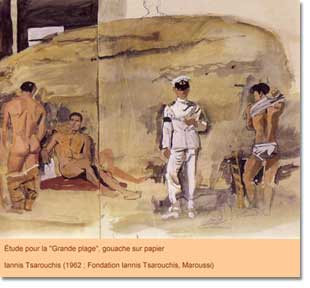
Olivier Philipponnat et Patrick Lienhardt,
Roger Stéphane, Grasset, Paris, 2004, p. 189.